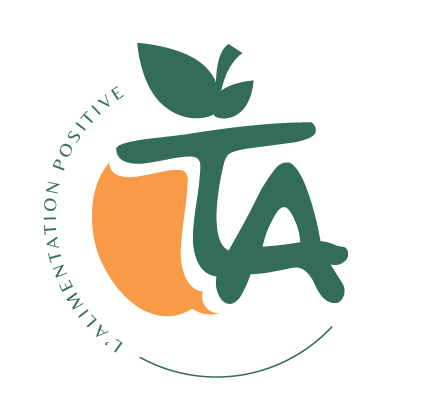La prévention santé au travail est au cœur des obligations légales de l’employeur. Selon le Code du travail, toute entreprise doit garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette responsabilité implique non seulement une vigilance constante, mais surtout la preuve de mesures concrètes mises en œuvre pour limiter les risques professionnels.
Cela passe notamment par des actions de prévention et de formation, l’évaluation régulière des risques via le DUERP, l’adaptation des conditions de travail en réponse aux risques identifiés…
Dans cet article, découvrez les notions clés de la prévention, les obligations juridiques de l’employeur, ainsi que les étapes concrètes pour bâtir une démarche de prévention efficace en entreprise.

Guide - 25 idées concrètes pour améliorer la santé des salariés en entreprise
Recevez gratuitement votre guide !
Comprendre les bases de la prévention santé au travail
Définition
Selon l’OMS et le Code du travail, la prévention santé au travail vise à préserver la santé physique, mentale et sociale des salariés dans le cadre professionnel.
Cette démarche englobe donc toutes les mesures mises en place par les entreprises pour éviter et réduire les risques professionnels en matière de santé et sécurité (1).
1. Les notions essentielles
Danger et risque
Il est nécessaire de distinguer deux concepts en prévention des risques professionnels : le danger et le risque.
- Danger : Tout élément (matériel, équipement, situation de travail…) qui peut engendrer un dommage à la santé des travailleurs.
- Risque : Le risque représente la probabilité qu’un salarié soit effectivement exposé à un danger.
Exemple
Un produit chimique toxique constitue un danger potentiel pour la santé.
Si un salarié utilise ce produit dangereux sans équipement adapté ni formation, elle est confrontée à un risque élevé.
Au contraire, si le même produit est stocké dans un local fermé à clé, correctement étiqueté, et jamais utilisé ni manipulé par les salariés, il ne représente alors pratiquement aucun risque.
Cette distinction est essentielle, puisqu’elle permet aux entreprises de prioriser les actions à mener, en concentrant leurs efforts là où la probabilité de risque est la plus élevée.
Travail réel et travail prescrit
Une bonne évaluation des risques ne doit pas reposer sur le travail tel qu’il est défini sur papier (travail prescrit), mais bien sur la réalité pratique et quotidienne des salariés (travail réel).
- Travail prescrit : Il s’agit de l’ensemble des procédures et consignes définies par l’entreprise pour réaliser un travail donné.
- Travail réel : C’est la réalité quotidienne du salarié sur le terrain, avec ses contraintes, ses imprévus et les adaptations qui sont nécessaires.
2. Les grands enjeux de la prévention
La prévention santé au travail s’articule autour de quatre enjeux principaux :
Enjeux humains : Protéger l’intégrité physique et mentale des salariés, prévenir la désinsertion professionnelle, adapter les postes de travail et anticiper le vieillissement des employés.
Enjeux juridiques : Selon le Code du travail et notamment la loi Santé au Travail, l’employeur a une obligation légale de garantir la sécurité et protéger la santé des travailleurs. La responsabilité civile et pénale de l’entreprise peut être engagée en cas de manquements.
Enjeux économiques : Une politique de prévention bien menée permet de réduire les coûts directs liés aux accidents du travail, maladies professionnelles, arrêts maladie, mais aussi certains coûts indirects comme les coûts de remplacement, la perte de production…
Enjeux sociaux : Enfin, la prévention contribue à améliorer le climat social, à fidéliser les salariés et à renforcer l’attractivité de l’entreprise auprès de futurs candidats.
3. Les trois niveaux de prévention
Selon France Travail, une entreprise doit agir sur trois niveaux de prévention pour structurer ses actions de prévention (2) :
- La prévention primaire permet d’éviter la survenue des risques en agissant directement à la source.
- La prévention secondaire vise à identifier de manière précoce et réduire les impacts des risques persistants.
- La prévention tertiaire a pour objectif de limiter les conséquences des incidents déjà survenus et accompagner les personnes concernées.
Quelques exemples concrets
Évaluer les risques professionnels via le DUERP, former les managers, adapter les horaires de travail en cas de canicule… → Prévention primaire
Former en continu et sensibiliser les cadres et les équipes aux différents risques, mener des actions de dépistage, mettre en place une cellule d’écoute, avoir un contact référent en cas de harcèlement… → Prévention secondaire
Aménager les posts après une maladie ou un accident, accompagnement le réintégration professionnelle, proposer un suivi psychologique post-accident… → Prévention tertiaire
À savoir
Ces différents niveaux de prévention sont complémentaires. Ainsi, plus une entreprise agit à un niveau primaire, et moins elle aura besoin d’intervenir au niveau tertiaire.
Les obligations de l’employeur : ce que dit le Code du Travail
Selon les articles L4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, tant pour leur santé physique que mentale.
Il s’agit d’une obligation de moyens renforcés : l’employeur doit prouver qu’il a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Les 9 principes généraux de prévention
L’article L4121-2 du Code du travail définit neuf principes généraux pour guider les actions de prévention dans l’entreprise (3) :
- Éviter les risques
- Évaluer les risques
- Combattre les risques à la source
- Adapter le travail à l’homme
- Tenir compte de l’évolution technique
- Remplacer ce qui est dangereux
- Planifier la prévention
- Prendre des mesures de protection collectives
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ces principes s’appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et permettent de hiérarchiser les actions de prévention à entreprendre.
Le DUERP et ses exigences
Le DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) est obligatoire pour toutes les entreprises. L’employeur y recense les différents risques auxquels peuvent être exposés ses salariés, ainsi que les actions de prévention mises en place (4).
Ce document doit être mis à jour annuellement au minimum, conservé pendant 40 ans, et être accessible aux salariés et anciens salariés, ainsi qu’à l’inspection du travail.
Un dépôt dématérialisé sur une plateforme nationale était initialement prévu par la réforme de la Loi Santé au Travail de 2022, mais le projet semble depuis avoir été annulé.
Les principaux risques à évaluer dans le DUERP
Pour que la démarche de prévention santé au travail soit efficace, l’évaluation dans le DUERP doit couvrir l’ensemble des risques, qu’ils soient physiques, psychosociaux ou organisationnels (5).
- Risques physiques : chutes, bruit, TMS, chaleur, froid, produits chimiques…
- Risques psychosociaux : stress, surcharge de travail, harcèlement, conflits, isolement…
- Risques organisationnels : rythme de travail intense, horaires décalés, déséquilibre vie pro / vi perso…
L’identification de ces risques est une étape à ne pas négliger, car elle permet ensuite de mettre en place des actions de prévention adaptées et de garantir un environnement de travail plus sûr.
Quelles conséquences en cas de non-conformité ?
En cas de manquement à ces obligations, la responsabilité civile, pénale ou administrative des entreprises peut être engagée.
- Civile : réparation financière en cas de faute inexcusable.
- Pénale : en cas de manquement à l’obligation de sécurité, en cas de dissimulation d’un risque connu.
- Administrative : sanctions possibles de l’inspection du travail (amendes, injonctions).
5 étapes pour construire une démarche de prévention santé au travail
Pour qu’une politique de prévention fonctionne, elle doit être collective, structurée et suivie dans le temps. Cela implique que chacun dans l’entreprise, du dirigeant aux salariés, participe activement à l’identification des priorités, à la planification des actions et à l’évaluation de leurs résultats.
En parallèle, il est important de valoriser et de promouvoir ces actions pour renforcer l’engagement de tous les acteurs de l’entreprise autour de cette démarche.
L’INRS définit 5 étapes principales pour construire une démarche de prévention santé au travail (6).
1. Mobiliser les acteurs concernés
Mettre en place une véritable culture de la prévention nécessite l’implication de tous les acteurs en interne.
- La direction et les managers doivent porter la démarche, la rendre visible et s’assurer que les ressources sont suffisantes pour qu’elle s’inscrive dans la durée.
- Les représentants du personnel et les services de santé au travail doivent être associés aux réflexions et aux actions.
- Enfin, tous les salariés, à leur niveau, participent à la prévention : en repérant les risques, en appliquant les mesures décidées, et en signalant les difficultés rencontrées sur le terrain.
2. Évaluer les risques
Cette étape consiste à identifier, analyser et hiérarchiser les risques auxquels sont exposés les salariés. Cette évaluation doit être actualisée régulièrement pour rester pertinente face à l’évolution des situations de travail.
Méthodes à utiliser :
- Observations directes sur le terrain
- Questionnaires internes diffusés aux salariés
- Entretiens individuels ou collectifs
- Audits internes et externes
- Indicateurs RH (absentéisme, turnover, accidents…)
3. Créer un plan d’actions de prévention
Les résultats de l’évaluation des risques professionnels doivent être clairement formalisés dans le DUERP, accompagné d’un plan d’action concret.
Les actions doivent être alignées sur les 9 principes généraux de prévention du Code du travail et être priorisées selon plusieurs critères :
- La fréquence des risques identifiés
- La gravité potentielle des dommages
- La faisabilité des actions envisagées
- L’impact prévu des mesures à court et long terme
À savoir
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, la création d’un Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT) est obligatoire depuis 2022.
Il permet de planifier, sur une ou plusieurs années, les actions de prévention à mettre en œuvre dans l’entreprise, en réponse aux risques identifiés dans le DUERP.
4. Mettre en œuvre concrètement les actions
La phase opérationnelle consiste à intégrer la prévention au cœur des pratiques quotidiennes de l’entreprise. Cela se traduit concrètement par :
- La mise en place de nouvelles procédures.
- Le changement ou le renouvellement des équipements.
- La réorganisation du travail (horaires, tâches, aménagements spécifiques).
- La formation et la sensibilisation continue des salariés et des managers.
- Une communication régulière sur les actions et résultats obtenus…
5. Suivre la démarche et évaluer la prévention
Cette dernière étape permet de mesurer concrètement l’efficacité des actions entreprises et d’ajuster la démarche si nécessaire. Elle implique de :
- Définir des indicateurs précis pour mesurer les progrès (réduction du nombre d’accidents, diminution de l’absentéisme…).
- Recueillir des retours d’expérience réguliers auprès des salariés.
- Revoir et ajuster les objectifs initiaux en fonction des résultats obtenus et des nouveaux risques identifiés.
Poursuivez votre lecture
Prévention nutrition : Comment sensibiliser vos salariés ?
Santé des femmes au travail : L’angle mort de votre prévention ?
Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail : Comment l’organiser et la réussir ?

Guide - 25 idées concrètes pour améliorer la santé des salariés en entreprise
Recevez gratuitement votre guide !
Sources :
(1) CNFCE. (2023, 7 juillet). Prévention santé au travail : quels outils en entreprise ? – FAQ CNFCE.
https://www.cnfce.com/faq/gestes-et-postures/prevention-sante-au-travail-quels-outils-en-entreprise
(2) francetravail.fr. (2024, août 20). Prévention en santé au travail : avez-vous les bases ? France Travail.
https://www.francetravail.fr/employeur/des-conseils-pour-gerer-vos-ress/qvt-bien-etre-salaries/prevention-des-troubles-musculo.html
(3) Principes généraux de la démarche de prévention. Neuf principes généraux de prévention – INRS.
https://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/Principes-generaux-prevention.html
(4) Qu’est-ce que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ? (2024, août 7). Entreprendre. Service-Public.fr.
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F35360
(5) Prévention des risques. (s. d.). Travail-emploi.gouv.fr | Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.
https://travail-emploi.gouv.fr/prevention-des-risques
(6) Mise en œuvre d’une démarche de prévention. INRS.
https://www.inrs.fr/demarche/mise-en-oeuvre-prevention/ce-qu-il-faut-retenir.html